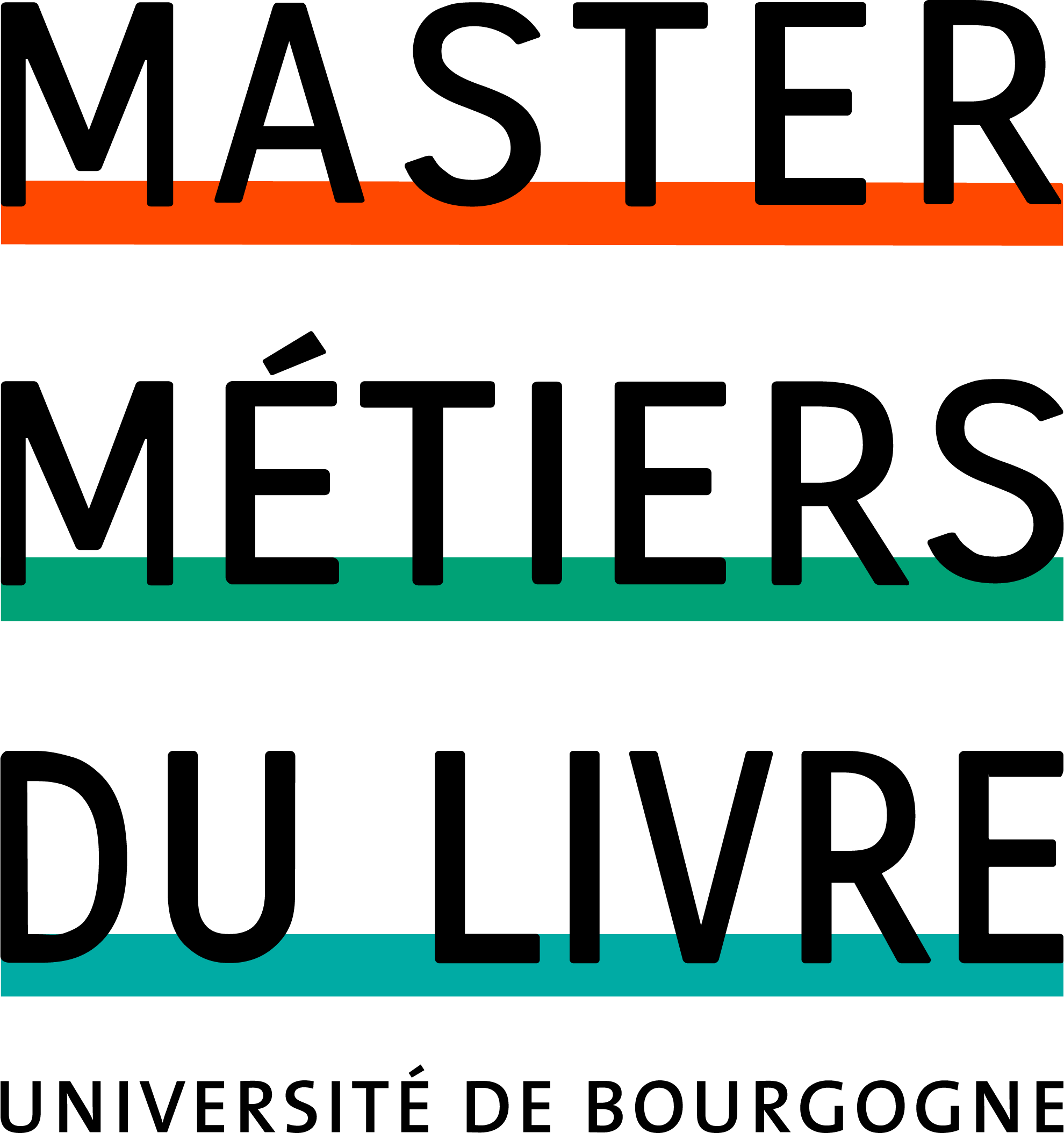Le texte – dans le cadre de la Journée d’étude – de Thierry Beinstingel, écrivain français, auteur de Ils désertent, Fayard, 2012, sélectionné pour le Prix Goncourt, Faux nègres, Fayard, 2014, La Vie prolongée d’Arthur Rimbaud, Fayard, 2016 :
Tout d’abord, vous dire combien je suis heureux de participer à cette journée d’étude « Métiers du livre : mythe et réalité ». Je remercie particulièrement Marie-Ange Fougère qui a eu la bonne idée de m’inviter à échanger avec vous sur ces thèmes et, en ce qui me concerne, sur les mythes et les réalités du travail d’auteur, d’autrice, d’écrivain ou d’écrivaine.
Lorsqu’on m’a demandé le titre de mon intervention, spontanément m’est venu en tête cette assertion « lire c’est trancher », phrase qu’un participant à un atelier d’écriture que je venais d’animer quelques jours plus tôt, m’avait signifié de façon, péremptoire, accompagnée d’un geste du tranchant de la main. J’ai utilisé cette expression parce qu’elle me semblait correspondre tout à fait à la réalité du travail d’écrivain que j’accomplis, travail à la fois changeant, si loin du mythe de l’écrivain solitaire, mais au contraire tourné vers les autres, fait ’opportunités, de changements, d’actualités permanentes, avec en ligne de mire bien entendu toujours la préoccupation du langage et des mots qui constituent pour moi une matière première. En effet, le hasard, le goût des rencontres, la curiosité permanente venait de me faire accepter cet atelier d’écriture dans ma ville à destination d’un public de migrants mineurs en grande difficulté à la fois de langue et d’insertion. Aussi, lorsque j’ai tenté avec eux de leur demander ce que signifiait lire (ou écrire, qui est son complément), eux, dont certains n’ont pas dépassé trois mois au total de scolarité dans des pays aussi divers que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée, voire même la Gambie qui demeure anglophone, j’ai été surpris et ravi de cette réplique « lire c’est trancher », accompagnée du geste de la main qui en marquait non pas leur propre rupture avec la scolarité, mais plutôt, osons le dire, l’incontournable besoin vital de savoir lire. « Lire c’est trancher » et bien sûr écrire c’est trancher aussi. Et c’est important de revenir à cette exigence fondamentale d’un art : oui, « lire » – et son corollaire, ou plutôt son inévitable verbe jumeau d’« écrire » – c’est trancher, à la fois se retrancher, prendre de la hauteur, s’isoler, et, en même temps, trancher comme choisir, opter, préférer, favoriser tel mot plutôt qu’un autre, telle voie (telle voix) plutôt qu’une autre, faire en sorte que la petite fabrique de temps de lecture (et d’écriture en amont) que forme un livre, réussisse à être à la fois singulière, c’est-à-dire dirigée vers un lecteur unique, intime, et en même temps universelle, c’est-à-dire partagée par tous.
Bien sûr, il y a hiatus entre lire et écrire. Et celui qui lit, en fonction de son passé, de son habileté, de son vécu, de son expérience de lecteur ne sera jamais celui qui a écrit le livre, ne pourra jamais pénétrer dans ses pensées, même si souvent (on peut l’espérer), le lecteur se sent en parfaite adéquation avec l’auteur. De là, de cette impossibilité de rejoindre celui qui écrit, naît la dimension mythique, mythologique comme disait Roland Barthes, de l’écrivain. Et comme pour tout art, peinture, sculpture, cinéma, musique, ou toute activité humaine qui tend à nous élever au-delà du monde commun, comme la religion, la littérature véhicule une sorte d’aura magique et on enferme les prêtres qui s’y adonne dans des représentations séculaires.
En France, il me semble (ce n’est pas le cas aux USA), nous avons le mythe de l’écrivain enfermé à sa table de travail (sa table de peine, dit l’écrivain Pierre Bergounioux), attendant que le rayon magique de l’inspiration pénètre par une fenêtre et le frappe au front comme une bénédiction (a contrario l’angoisse de la page blanche est sa malédiction). Dans cet ascétisme qui tient de la caricature (je suis conscient de forcer le trait), il ne vient à personne l’idée que l’auteur puisse avoir des besoins élémentaires, des soucis d’impôts, de loyer à payer, de lessives à faire, de « que vais-je faire à manger ce soir ? ». De temps à autre, l’écrivain sort de sa tanière et il n’étonne personne de le voir frais et dispo, avouant à la radio ou à la télévision, une écriture qui lui a pris plusieurs années de sa vie. On boit, on gobe ses paroles, on imagine un labeur sans relâche. Un des derniers représentants de ce mythe a été personnifié par Jean d’Ormesson. Ma mère aime beaucoup Jean d’Ormesson : « ça, c’est un écrivain » dit-elle. Et lorsque j’ai cessé mon activité professionnelle chez Orange, elle ne cessait de me demander comment se passait ma retraite, alors que je m’évertuais à lui répéter que, maintenant, mon seul métier était d’écrire : voilà l’illustration d’une confrontation directe entre le mythe et la réalité : d’un côté d’Ormesson dans l’apparence et la vieille tradition de l’écrivain rentier, dont jamais elle n’a remis en cause son statut, et, de l’autre, son fils, côtoyé tous les jours, pour lequel elle demeure dans l’impossibilité de l’imaginer en train d’écrire.
J’ai parlé de « métier » au sujet de l’écriture. C’est une position qui m’est personnelle : j’ai partagé deux activités pendant quinze ans, l’une chez Orange dans divers services, qui a largement débordé sur l’autre activité d’écriture, de telle manière qu’il m’a été impossible de choisir quel « métier » influençait l’autre, celui, lucratif en tant que responsable de ressources humaines, ou celui, moins rémunérateur mais tout aussi organisé et soumis aux règles de l’édition. Pour corser le tout et ajouter une autre direction à cette schizophrénie, j’ai repris des études universitaires de lettres ici même à l’université de Dijon qui ont abouti fin 2017 à une thèse de doctorat concernant la littérature du travail dans sa dimension contemporaine. Cette revendication en terme de « métier » qui m’est propre, est rarement partagée, mais paradoxalement, ceux qui refusent cette appellation, souvent pour simplement annuler le côté « procédé », mercantile, ou répétitif qu’une profession peut véhiculer, servent à entretenir le mythe, à laisser perdurer l’apparition divine de l’inspiration en dehors de toutes contingences. Mais c’est aussi parce que nous sommes perméables à ces représentations, à ces mythes depuis l’enfance et l’éducation que nous avons reçue, notre scolarité ne fait qu’appuyer sur ces images : Rimbaud, que j’ai approfondi dans Vie prolongée d’Arthur Rimbaud, est l’archétype de la vision éthérée du poète maudit et génial, au risque d’en oublier sa vie ultérieure en Afrique, beaucoup plus matérielle et prosaïque : là encore, d’un côté le mythe, de l’autre la réalité. Les réactions parfois vives au sujet de l’uchronie que j’avais publiée montrent bien l’imprégnation jusqu’aux tréfonds de notre personnalité des mythes fondateurs.
Mais métier d’écrivain, il y a bien : lorsque j’ai publié Central en 2000, mon premier roman chez Fayard, j’ai eu la chance d’assister, dans la petite cour pavée de la rue des Saints-Pères au cœur de Paris où se tenait alors ma maison d’édition, à l’arrivée de mon livre, tout juste fabriqué, qu’un camionneur, soufflant et suant sous l’effort et l’exiguïté des lieux, livrait sous la forme d’une palette recouverte d’un plastique dans laquelle je voyais en transparence les exemplaires fabriqués en série. Et d’un coup s’est exposé tout ce qu’impliquait comme réalité, force de travail et compétences, la simple imagination qui m’avait conduit à élaborer ce premier roman. Qu’un livreur ait pu ici acheminer avec difficulté le livre fabriqué, qu’un manutentionnaire ait pu les dresser auparavant sur une palette, puis les recouvrir d’un film plastique, qu’un imprimeur ait pu procéder à la réalisation des exemplaires, m’apparaissait comme une sorte de pouvoir prodigieux qui n’avait tenu initialement qu’à un vague agencement de mots dans ma tête. Et bien entendu, la liste est longue des professions qui s’y ajoutent : employés d’éditions, attachés de presse, journalistes, libraires, bibliothécaires, j’en oublie probablement des dizaines.
Demeure tout de même la question du statut de l’écrivain, de sa place et de son rôle. Lorsque je travaillais encore chez Orange et que je cumulais en parallèle les publications, j’avais un statut étrange : d’un côté, bien qu’accomplissant à temps plein et avec foi mes missions dans un service de Ressources humaines, mon employeur me considérait comme une sorte d’intermittent du travail ; de l’autre, lorsque je valorisais mon activité littéraire dans des rencontres, des salons, des librairies ou même chez mon éditeur, je passais également
pour une sorte d’amateur de l’écriture, simplement parce que je ne correspondais pas à l’idée – mythique – qu’un écrivain digne de ce nom doit se consacrer uniquement à l’écriture.
Par goût, il se trouve que j’échange ou que je rencontre régulièrement plusieurs auteurs (l’isolement des écrivains entre eux est aussi une idée reçue qu’il faut combattre). Nous parlons de nos préoccupations d’écriture, d’éditeurs, de nos difficultés : j’aime à résumer ces conversations par l’expression « on parle popote ». Dans ceux qui ont choisi de se consacrer exclusivement à l’écriture, l’une vit avec le salaire de son mari, une autre a du mal à joindre les deux bouts et multiplie les projets d’ateliers d’écriture, une troisième a eu la chance d’avoir un très gros succès de librairie qui l’a mise à l’abri des préoccupations financières, l’un, haut fonctionnaire, est actuellement en disponibilité de l’État, un autre enfin, pourtant reconnu, cumule les projets à soixante-six ans pour pouvoir s’en sortir : voilà la réalité d’un monde dont les règles de rémunérations ont été fixées il y a 180 ans, notamment par Hugo, Balzac, Dumas, Georges Sand, Zola.
Un contrat d’édition octroie 10 % à l’auteur, soit 2 euros environ par livre : pour vivre décemment et uniquement « de sa plume » en publiant régulièrement tous les deux ans, il faudrait que chaque publication atteigne vingt à vingt cinq mille exemplaires, alors que le tirage moyen d’un ouvrage est de moins de cinq mille à l’heure actuelle. Personnellement, seuls deux de mes titres ont atteint environ cinq mille ventes (les deux romans nominés au Prix Goncourt : Ils désertent, paru en 2012, 5467 exemplaires au 31/12/2018 et Retour aux mots sauvages, paru en 2010, 4600). Un système d’à-valoir (qui n’est pas pratiqué par tous les éditeurs), c’est-à-dire une somme versée à l’auteur en prévision des ventes, permet d’en atténuer très modestement les effets…
Alors de quoi vivent les écrivains ? Beaucoup ont conservé leurs métiers, certains écrivent des articles journalistiques, font des traductions, travaillent comme correcteurs pour des éditeurs, d’autres interviennent dans des résidences rémunérées, des structures d’événementiels liés à la filière du livre ou pratiquent des ateliers d’écriture et deviennent en quelque sorte des travailleurs sociaux au risque de ne plus avoir ni le temps ni l’envie d’écrire : voilà la réalité qui s’oppose au mythe.
Mais revenons à l’essence même du travail de l’écrivain, car là se situe le dynamisme, l’optimisme, ce qui fait avancer encore et toujours et jamais renoncer : les mots, le langage, cette matière première à travailler sans cesse. Là aussi, je me permets apporter quelques exemples de la réalité d’écriture partagée avec d’autres auteurs : l’une met à chaque fois trois ou quatre ans pour rédiger un roman. Entre son idée de départ et les deux cents ou trois cents pages à l’arrivée, elle a éliminé les trois quarts de ce qu’elle avait rédigé, elle s’est documentée, à voyagé, a laisser en elle s’installer le livre jusqu’à ce qu’il la dévore. Elle sort exténuée et attend à chaque fois beaucoup de la parution d’un livre. Une autre part dans des projets à multiples entrées. Ses livres ne sont jamais linéaires, ce sont des dispositifs artistiques : à elle les petits éditeurs qui sauront détecter la puissance de ce qu’elle écrit. Les grandes maisons ne la publient pas : elle demeure décalée, trop originale, au-delà des attentes convenue d’un lectorat. Une autre encore écrit à la plume, dans son manoir de Touraine, entourée de ses chats. C’est elle qui se rapproche le plus du mythe de l’écrivain. Chacune de ses parutions est une réussite. Elle est brillante partout et vend beaucoup à l’étranger. Mais elle pense aussi que son succès est un malentendu, qu’il est artificiel. Celui qui est haut-fonctionnaire en disponibilité est aussi proche du mythe de l’écrivain. Il publie beaucoup de romans sur un fond historique sans faille, il a ses admirateurs. Le dernier enfin s’est définitivement tourné vers le monde numérique, malgré qu’il soit toujours autant sollicité pour ses ouvrages précédents et son extraordinaire culture.
Quant à moi, ma réalité d’écriture est constituée d’instants : ouvrir mon ordinateur et l’écrit en cours dès le réveil, parfois ne s’y plonger que longtemps après, parfois avoir peur, non pas de la page blanche, mais de s’y mettre, de continuer à aligner les mots, et puis quand même s’installer, rédiger, parfois avec hâte, précipitation, avec l’impression que les mots vous brûlent (généralement je m’arrête, je lance une lessive, prépare le repas). C’est quelque chose de permanent, de difficile à quantifier, qui se passe le jour, mais aussi la nuit (où on se réveille pour noter la phrase qui vous traverse), avec parfois le moment délicieux où on ne se souvient plus où on à garé la voiture tellement on est pris. Mais rien de pesant toutefois, pas un travail au sens dur du terme, plutôt quelque chose d’aérien, de suspendu dans l’air, quelque chose qui me tire depuis une vingtaine d’années, comme si je jonglais avec des clés à molettes, les mots comme des pinces à linge, les paragraphes qui sèchent aux nuages, les livres constitués qui retombent sur terre, alourdissent ma table, les miens, ceux des autres. En fait, l’idée du mythe et de la réalité se glisse probablement dans ces interstices, et au final m’indiffère. Je regarde ou j’écoute quelques d’Ormesson dans des émissions littéraires, parfois j’en suis et je me demande ce que les auditeurs ou les spectateurs peuvent penser de moi. Qu’imaginent-ils ? Quelle vie me prêtent-ils ?